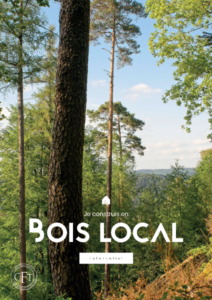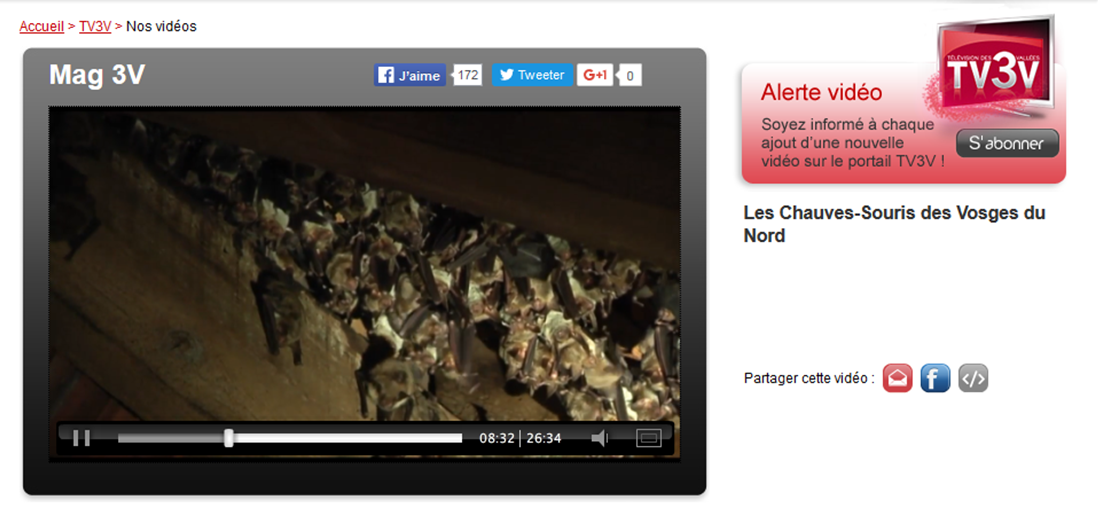Les rivières : Et au milieu coulent la Sauer et le Seltzbach
Changeantes au cours des saisons : apportant un peu de fraicheur en été, menaçantes en période de fortes pluies, dévoilant des figures artistiques avec le gel en hiver… Ayant profondément marqué l’organisation de nos vallées : implantation d’activités industrielles (moulins, forges, scieries), développement des villages, colonne vertébrale pour les déplacements…. Zones refuges pour une faune et une flore spécifiques….
Les rivières sont des milieux riches, dynamiques mais aussi fragiles. A travers ce dossier, nous vous proposons de découvrir « au fil de l’eau » la Sauer, le Seltzbach et leurs affluents qui parcourent le territoire Sauer-Pechelbronn.
La Sauer

La Sauer, caractéristique des cours d’eau sur grès des Vosges du Nord, présente, dans sa partie située sur notre territoire, une bonne qualité physique, chimique et biologique.
Reconnue pour la richesse de ses habitats naturels, elle a été intégrée au réseau européen des sites NATURA 2000 et abrite des espèces animales rares et protégées tels que le chabot, la lamproie de Planer (poissons), le cuivré des marais (papillons) ou le Gomphe Serpentin (libellule).
Le Seltzbach
Des milieux fortement perturbés
Même si les deux cours d’eau présentent des caractéristiques très différentes, ils ont tous deux été profondément marqués au cours de l’Histoire par les activités humaines, à la fois d’un point de vue physique (modification des berges et du lit) et chimiques (pollutions diverses).
Aujourd’hui, les principales perturbations auxquelles ils doivent faire face sont :
– La multiplicité de petits aménagements : étangs, prises d’eau, buses, seuils…
– Les travaux hydrauliques : curage, rectification, artificialisation du lit et des bergers…
– Des mauvaises pratiques de gestion : plantation de résineux, remblais, dépôts divers (déchets, gazon…), introduction d’espèces invasives (renouées du Japon, balsamine de l’Himalaya…)….
Autant de perturbations à l’origine de dysfonctionnements de la dynamique des cours d’eau : appauvrissement du milieu qui devient moins attractif pour les poissons, dégradation de la qualité chimique de l’eau, difficulté pour les poissons de franchir certains obstacles, érosion des berges, ensablement excessif.
Et vous, comment faire pour agir en faveur de nos rivières ?
Rappel réglementaire
Il est rappelé qu’il appartient à chaque riverain d’entretenir lui-même la partie du cours d’eau qui lui incombe, cet entretien régulier ayant pour objectif de «permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ». (article L215-14 du code de l’environnement).
Toute intervention sur la berge nécessite néanmoins de disposer des autorisations réglementaires délivrées par la Direction Départementale des Territoires (contact : DDT du Bas-Rhin, 14 rue du Maréchal Juin BP 61003 67070 STRASBOURG CEDEX – 03.88.88.91.00).
Des bonnes pratiques de gestion
Vous pouvez aussi, dans vos pratiques quotidiennes, contribuer à l’amélioration de la qualité de nos cours d’eau : ne pas utiliser de produits phytosanitaires, éloigner le compost ou les dépôts de gazon des berges, éviter de planter des végétaux non endogènes et non adaptés au cours d’eau…
Plus de détails dans :
- le guide des bons gestes pour préserver nos rivières édité par le Parc naturel régional des Vosges du Nord : guide à consulter.
- le guide de l’entretien régulier des cours d’eau édité par le SDEA Alsace Moselle : guide à consulter.
Les forêts
La forêt est une composante majeure de nos paysages. A la fois réservoir de biodiversité, productrice de bois, ou hôte de multiples activités de loisirs, la forêt revêt de multiples visages et assure de nombreuses fonctions.
Réservoir de biodiversité :
Outre les essences forestières qui les composent, nos forêts servent aussi de refuge à de nombreuses espèces floristiques et faunistiques (chevreuil, martre, blaireau, sanglier, pic noir…).
Productrice de bois :
L’association « Les charbonniers » fait revivre au Fleckenstein la technique ancestrale de production de charbon qui alimentait les industries (verrerie, fonderie) qui existaient dans la vallée.
Aujourd’hui, la forêt est fréquentée par les exploitants forestiers et continue à faire vivre localement des scieries et quelques artisans ébénistes et menuisiers. Elle est également source d’énergie, pour les nombreux particuliers qui fendent encore leur bois et pour certaines collectivités qui se sont équipées en chaudière alimentée par des plaquettes forestières.
Accueil d’activités de loisirs :
La forêt attire de nombreux randonneurs, VTTistes, ou autres amoureux de la nature qui parcourent les nombreux sentiers balisés par le Club Vosgien. La chasse est aussi une activité très prisée dans nos massifs boisés.


Un patrimoine à conserver et à valoriser :
Entre 2010 et 2015, un travail a été mené avec les acteurs de la forêt et de la filière bois sur le devenir de ce patrimoine, avec la concrétisation de projets démonstrateurs :
- La construction du pôle bois, bâtiment d’activités dédié aux professionnels du bois sur le parc économique de la Sauer à Eschbach, désormais occupé par l’entreprise Les Bois du Ried.
- La construction d’un bâtiment pilote en bois local (hêtre et pin sylvestre) à Preuschdorf, désormais occupé par un logement et par la K’Fet du K’Ro.
- La réalisation d’un guide : « Je construis en bois local » en partenariat avec le Parc naturel régional des Vosges du Nord et Fibois Alsace
Le Parc naturel régional des Vosges du Nord a par ailleurs élaboré une charte forestière de territoire : https://www.parc-vosges-nord.fr/article/une-charte-forestiere-pour-valoriser-le-bois-local
Composition des forêts de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn

Chauve-souris online
La plus grande maternité d’Alsace !
L’église de Niedersteinbach accueille l’un des plus importants gîtes de mise-bas de Grand Murin d’Alsace. Depuis 2014, 2 caméras sont connectées en continu dans les combles de l’église pendant la période de présence de la colonie, du début du printemps à la fin de l’été. Les femelles se regroupent pour mettre bas et élever leur unique jeune.
Chauve-souris online
Pour pouvoir mieux les observer, un équipement vidéo infra-rouges a été installé dans les combles début 2014 et une retransmission permet de suivre la vie de la colonie : le toilettage, l’allaitement, les envols des femelles, le déplacement des petits… Vous pourrez peut-être même assister en direct à des mises-bas !
Mais aucun mâle adulte à l’horizon : pendant cette période, ils se tiennent à l’écart !
Vous pouvez également vous rendre directement à Niedersteinbach : les images sont retransmises sur un écran situé à la mairie, à côté de l’église.
Pour entrer dans l’intimité des chauve-souris, cliquez sur les images ci-dessous et accéder directement aux caméras!
La colonie se déplace régulièrement dans les combles au cours de la journée. Il se peut donc que vous ne voyiez pas directement les chauve-souris à l’écran : n’hésitez pas à déplacer vous même et à distance la caméra pour les retrouver !
A noter qu’une fois que les petits ont pris leur envol et que la colonie a déserté les lieux, les caméras sont désactivées. Rendez-vous dans ce cas au printemps suivant!

En complément, découvrez ici le reportage co-produit par la communauté de communes, le Parc naturel régional des Vosges du Nord et TV3V sur les Chauves-Souris des Vosges du Nord.
Des chauves-souris et des hommes… où l’histoire d’une cohabitation en plein cœur de Niedersteinbach
Le saviez-vous ?
Chaque année, entre 600 et 1000 femelles de Grand Murin (Myotis Myotis), une espèce de chauve-souris protégée au niveau national et reconnue d’intérêt communautaire, prennent quartier dans les combles de l’Eglise catholique de Niedersteinbach, pour y mettre bas.
Il s’agit de la plus grande colonie répertoriée dans les Vosges du Nord !
Les premières femelles arrivent au courant du printemps et quittent la colonie entre fin août et mi-septembre, dès lors que leurs petits sont autonomes.
Pendant cette période, vous pouvez observer sur place dès la tombée de la nuit la sortie des femelles qui gagnent leurs terrains de chasse.
Une cohabitation pas toujours évidente
La cohabitation n’a pas toujours coulé de source entre usagers de l’église et la colonie… Dans le cadre du programme d’actions du document d’objectifs du site Natura 2000 « La Sauer et ses affluents », porté par le Parc naturel régional des Vosges du Nord, la pose d’un plancher en bois au-dessus du chœur de l’église a permis d’améliorer l’accueil du Grand Murin, de limiter les désagréments liés à la présence de la colonie (accumulation de guano, odeurs, etc.), tout en préservant l’édifice religieux et facilitant son entretien.
Le Grand Murin – carte d’identité

Reconnaissance
- Pelage dorsal doré à brun-gris, gorge et ventre blancs
- Museau long, large et fortement dénudé
- Oreilles grandes et larges
- Larges ailes brunâtres
Une des plus grandes chauve-souris européennes
- Tête + corps : 65-80 mm
- Envergure : 350-430 mm
- Poids : 20-40 g
- Vitesse maximale : 50 km/h
- Longévité moyenne : 5 ans
- Longévité maximale : 25 ans
Bon à savoir
La présence d’une colonie de chauves-souris dans vos combles est une aubaine :
- Leurs crottes, appelées guano, est un excellent engrais pour vos jardins. Posez une bâche au sol pour faciliter la récolte et protéger le plancher. Attention, ne dérangez pas la colonie : attendez son départ à l’automne pour prélever votre butin.
- Une colonie de 500 Grands Murins ingurgite une tonne d’insectes en une saison ! Le meilleur insecticide « bio » qui existe !
Oubliez vos idées reçues !
- Les chauves-souris ne sont pas aveugles
- Elles ne s’accrochent pas dans les cheveux
- Nos chauves-souris ne boivent pas de sang (trois espèces sont hématophages et vivent en Amérique du Sud, mais elles ne tuent jamais leurs proies)
- Elles ne pullulent pas, ne faisant en général qu’un seul petit par an.
- Elles ne rongent, ni ne détériorent les matériaux de construction.
Pour agir en faveur des chauves-souris :
- Si vous disposez d’une colonie dans vos combles, n’y faites pas de travaux pendant la période de reproduction (mai à septembre).
- Maintenez vos vieux arbres à gîtes et conserver les arbres creux ;
- Limitez l’utilisation des pesticides ;
- Construisez des gîtes artificiels ;
- Créez de la nourriture en attirant les insectes, par la plantation de fleurs locales riches en nectar ou la réalisation d’un compost.
Des questions complémentaires ?
Vous pouvez contacter le Parc naturel régional des Vosges du Nord
- 03 88 01 49 59
- info@parc-vosges-nord.fr
- www.parc-vosges-nord.fr

Chargée de mission environnement, développement local
0613269441